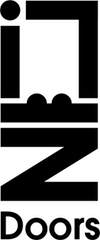Né à Djerba dans l’une des plus anciennes familles de Hara Sghira (le « petit quartier juif ») et élevé à Jérusalem dès l’âge de 2 ans, Rafram Chaddad revient pour la première fois en Tunisie en 2004 et s’y installe en 2014. Il y développe un travail artistique sur la mémoire, la présence quasi-invisible de l’histoire juive du pays – l’une des plus anciennes communautés au monde – dont il tente de réanimer les traces par des interventions dans l’espace public inspirées de personnes, de rites, d’objets et de matériaux inspirés du monde juif tunisien disparu.
La population juive des pays d’Afrique du Nord, qui comptait plus de 500 000 personnes dans les années 1940, en compte moins de 5 000 aujourd’hui. Pourtant, les traces de la présence de cette communauté multimillénaire subsistent, notamment de manière immatérielle, dans la musique, la cuisine et la culture du pays. On estime qu’entre les années 50 et 70, plus de 100 000 Juifs tunisiens ont émigré en France et en Israël. De nombreux membres de cette diaspora ne sont jamais retournés en Tunisie, mais ont développé une nostalgie de leur patrie comme d’un paradis perdu – une nostalgie familière à ceux qui vivent en exil. Dans ce contexte, la trajectoire de Rafram est perturbatrice, rétrograde, voire transgressive (la génération précédente affirmant avoir tourné le dos à son passé tunisien pour se reconstruire ailleurs, en France ou en Israël, souvent de manière difficile).
Dans un essai extrait du livre de Rafram Chaddad, l’universitaire Yigal Shalom Nizri parle du passage d’un « méta-espace hors des limites du temps et de l’espace » à la vie quotidienne dans l’espace réel. Cela fait écho au titre « Comme à Tunis » donné à l’événement à l’Hôtel Grand Amour, et aux expériences des enfants et petits-enfants des immigrés juifs tunisiens, qui ont souvent vécu dans de petites Tunisies recréées dans les appartements de leurs grands-parents ou dans des quartiers tels que le Faubourg Montmartre, Belleville et Sarcelles à Paris – à travers la cuisine, les objets, les rituels, les croyances et tous les signes culturels perpétués dans l’exil. En même temps, le geste de Rafram libère en quelque sorte un temps bloqué au moment de l’exil. Sa démarche est tout sauf nostalgique : il ne s’agit pas de reproduire le passé, mais de réactiver des lieux, des objets et des rituels de manière vivante et présente.
Dans cette discussion, nous avons évoqué la manière dont l’art de Rafram traite de la disparition de la présence juive en Tunisie – et l’impact de l’actualité du Moyen-Orient sur sa pratique en Tunisie – mais plus largement la manière dont ce travail artistique évoque des questions universelles telles que l’exil, la migration, la fragilité des frontières et la mutabilité des identités.